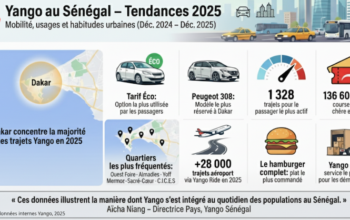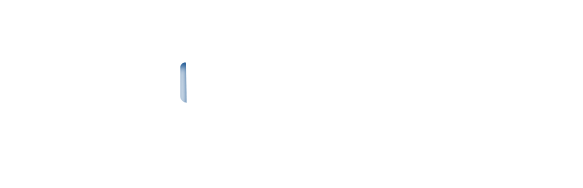J’ai toujours aimé l’eau. Dans mon enfance à Saint-Louis, au bord du fleuve Sénégal, elle me fascinait. Les marigots, les mares, les rizières inondées… j’aimais leur silence mystérieux. Mais plus encore, c’est le courant qui m’intriguait. Comment l’eau choisit-elle d’aller dans un sens et non dans l’autre ? Pourquoi ces mouvements contraires, ces flux qui ne s’épuisent jamais ? Je pouvais rester des heures à contempler cette danse, sans comprendre, mais en me laissant emporter.
Et pourtant, il y avait une matière que je détestais de tout mon cœur : la géographie. Ces cartes à apprendre par cœur, ces reliefs à mémoriser… moi qui n’avais pas une grande mémoire, je trouvais cela fastidieux, presque cruel. Ce n’est qu’à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis que tout a basculé. Dans un cours de Géopolitique, j’ai compris que la géographie n’était pas qu’une affaire de cartes : elle était au cœur de tout. À travers les lectures – Yves Lacoste (La Géographie, ça sert d’abord à faire la guerre), Zbigniew Brzezinski ou encore Henry Kissinger – j’ai saisi que les territoires ne se comprennent pas sans l’eau, et que l’eau elle-même est un invariant géopolitique.
Car au fond, la plupart des grands conflits du monde tournent autour de l’eau. Le Nil, disputé entre l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan. Le Tigre et l’Euphrate, sources de tensions séculaires au Moyen-Orient. Le partage du Jourdain, pierre d’achoppement entre Israël et ses voisins. Sans oublier les mers : la mer de Chine méridionale où s’affrontent les ambitions, ou encore l’Arctique que le réchauffement climatique rend à nouveau stratégique. Partout, l’eau est pouvoir, l’eau est arme, l’eau est vie.
Mais pour moi, l’eau reste aussi mystère. Ces immensités bleues sur les cartes, occupant plus des deux tiers de la planète. Ces océans à perte de vue où l’œil se perd et où l’esprit se tourne vers le divin. Comment Dieu maintient-il cet équilibre fragile ? Je me rappelle la sourate Ar-Rahman, dans le Coran, où Dieu évoque la rencontre des eaux, “entre lesquelles Il a mis une barrière qu’elles ne franchissent point”. Une métaphysique de l’eau qui m’émerveille et me renvoie à ma foi.
Et dans cette contemplation revient Victor Hugo à Villequier. Ravagé par la perte de Léopoldine, il se redresse pourtant, face à l’immensité de la nature, dans un dialogue direct avec Dieu. Dans ce poème, Hugo apostrophe le Créateur et rappelle combien l’homme est petit devant «”l’immensité de l’espace”, mais combien aussi cette petitesse, acceptée, devient chemin d’élévation. L’eau, l’océan, sont alors un miroir : ils écrasent notre orgueil, mais élèvent notre âme.
Ma passion de l’eau n’est pas étrangère à ma passion de l’écriture, de la lecture et de l’évasion. Car toujours, au bord de l’eau, je voulais m’évader, rêver, me perdre dans cet infini. Comme les poètes romantiques qui cherchaient au bord des lacs, des mers et des rivières une échappée vers l’ailleurs, j’ai toujours vu dans l’eau une source d’inspiration. Lire au bord du fleuve, écrire au bord de l’océan, rêver devant les marigots… tout cela formait pour moi une seule et même respiration.
Aujourd’hui encore, je passe du temps à regarder des vidéos, des images de mers et d’océans : la mer Rouge, la mer Baltique, la Méditerranée, l’Atlantique… Je suis toujours frappé de voir sur une carte du monde ce bleu massif, omniprésent, qui nous englobe. Comme un rappel permanent que l’homme est petit face à l’eau, à l’espace, à Dieu.
Pour le villageois que je suis resté, pour le berger que je suis encore, l’eau a toujours été une bonne nouvelle. Elle annonçait la saison, la promesse des récoltes, la survie du troupeau. Elle rythmait nos vies, elle guidait nos pas. À Saint-Louis, plus précisément à Gandiol, mon royaume d’enfance – comme Senghor parlait de Joal, son royaume d’enfance – chaque ruelle, chaque souffle du vent me ramenait vers le fleuve, comme si mon destin devait rester lié à cette source.
L’eau est donc mon origine, mon énigme et mon horizon. Elle est ma géographie intime. Elle m’a réconcilié avec les cartes que je haïssais jadis. Elle a nourri mon goût de la géopolitique. Elle a inspiré mon amour des mots. Et elle continue d’alimenter ma foi et ma curiosité. Car au fond, l’eau est ce qui relie l’enfant qui jouait au bord du marigot, l’étudiant ébloui par ses cours à l’Université, le poète en herbe cherchant l’évasion, et le journaliste IT que je suis devenu.